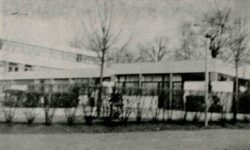L’origine de Saint-Cyprien – Epoque contemporaine (suite et fin)

Epoque contemporaine (suite et fin)
La 1ère Guerre mondiale (1914-1918)
Un très grand nombre d’hommes sont mobilisés au début de la 1ère Guerre Mondiale. Cependant, si l’on feuillette les anciennes délibérations des conseils municipaux, très peu de notes concernent la guerre, si ce n’est qu’en juin 1915, « à la demande des autorités, le conseil autorise la venue d’un cantonnement de prisonniers alsaciens », les bienvenus pour suppléer une main-d’œuvre restreinte aux travaux agricoles. Effectivement, Saint-Cyprien étant en zone rural, la bonne marche des exploitations agricoles est fortement perturbée par le conflit et les départs des hommes au front.
A l’époque, le maire s’appelle Jean-Baptiste Bourg et son adjoint Jean-Marie Garnier. En 1915, le maire décède et l’adjoint est mobilisé. Jean Béroud et Claude Pupier sont nommés respectivement 1er et 2ème délégué pour les remplacer « dans la plénitude de leurs fonctions ».
Aux élections de décembre 1919, Jean-Marie Garnier est élu maire, Fleury Loire adjoint et un régiment de la région bretonne est cantonné quelques temps dans le bourg.
En séance du 14 novembre 1920, se pose la question d’ériger « un monument commémoratif aux morts tombés au champ d’honneur ». En effet, 18 Cypriennois morts aux combats se doivent d’être honorés par la commune. La majorité d’entre eux sont morts aux combats sur la ligne de front dans le Nord de la France : 14 dans les départements de l’Oise, de l’Aisne, de la Meuse, de la Marne, de la Moselle et de la Somme. Les 4 autres font exception puisqu’ils sont décédés à Wursburg en Allemagne, sûrement dans le principal camp de prisonniers qui y était établit, à Paravolo en Serbie, à Seddul-Bahr en Turquie, durant la bataille du même nom, opposant les forces franco-britanniques aux ottomans, puisque la date de mort coïncide et à Zonnebeke en Belgique, durant la Première bataille d’Ypres qui eut lieu sur le territoire de cette commune puisque la date de mort coïncide également.
Une souscription avait été lancée quelques mois auparavant et avait rapporté 1850 anciens francs. Mais selon les renseignements fournis par plusieurs sculpteurs de la région à l’époque, un monument ordinaire coûtait au minimum 4500 francs. Le conseil décide, afin « d’honorer convenablement la mémoire de ces glorieux morts de la commune », d’ouvrir une nouvelle souscription, mais aussi de solliciter une aide auprès du Conseil Général et de compléter éventuellement la somme par la vente d’une propriété communale.
Finalement, la souscription rapporte la somme de 200 000 anciens francs, un monument est alors érigé devant l’église par l’entreprise Drutel et Olergeat de Saint-Etienne. Il coûtera 500 000 anciens francs et sera inauguré le le 6 août 1922.
Ce pilier commémoratif est bâti sous forme d’obélisque sur socle en pierre. Alors qu’une croix de guerre est sculptée au sommet du monument, il est orné de plusieurs autres éléments symboliques et décoratifs. On peut remarquer une guirlande de feuilles de chêne symbolisant la force, la puissance mais aussi les vertus civiques des soldats morts pour la France. On peut aussi voir un casque de soldat entremêlé avec un drapeau français et une palme qui est un symbole chrétien du martyr signifiant le deuil, l’affliction.
La vie Cypriennoise pendant l’entre-deux-guerres
La population a diminué : le recensement de 1921 n’a trouvé que 452 habitants. Cette année-là, un Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Société Coopérative Agricole d’Electricité de la Plaine du Forez décrit son programme.
Elle avait programmé l’alimentation en électricité pour tous les usages de force et de lumière de quelques 30 communes du Forez dont Saint-Cyprien. La coopérative devait assurer l’alimentation de treillis électriques à grande, moyenne et petite puissance ainsi que l’alimentation de batteuses et de presses syndicales à grand travail. L’emploi de treuil devait assurer l’assainissement des sols et l’abaissement du plan d’eau de surface en hiver humide.
Ils avaient estimé les travaux sur 2 – 3 ans afin que tous les services agricoles du Forez soient électrifiés. A Saint-Cyprien, comme dans les autres communes voisines, il y eu forcément du retard dû à la Grande Guerre…
Ce n’est finalement qu’en 1926 que l’électricité est installée à Saint-Cyprien et qu’en 1935 pour l’intégralité du village, hameau isolés compris.
De son coté, en 1933, le cimetière est agrandi et l’année 1937 voit l’élargissement du pont sur la Loire.
La plus grande partie des habitants vivent toujours de l’agriculture. Ce sont des petites fermes avec 4 vaches et employant quelques domestiques pour cultiver 5 à 10 hectares.
Par la suite, la culture maraîchère s’étend et prend de plus en plus d’importance. Déjà avant la guerre de 1939-1945, certaines fermières allaient jusqu’à Saint-Etienne, au marché, avec leur charrette attelée d’un âne ou d’un cheval. Celles qui n’ont pas d’attelage emmènaient leurs colis par le train depuis la gare d’Andrézieux, ensuite par le tramway pour s’installer au marché de la place du Peuple.
Après les moissons avec la moissonneuse-lieuse, les céréales sont battues à la batteuse actionnée par la machine à vapeur qui ponctue son travail par de puissants coup de sifflets. Ces travaux très pénibles donnaient l’occasion de bons repas avec la dégustation du pâté aux pommes.
Fait surprenant aujourd’hui mais commun à l’époque : tout le monde cultivait sa propre vigne, afin de produire son vin. Un pressoir du Syndicat Agricole était alors mis à disposition des Cypriennois. Certes, la vigne cypriennoise ne pouvait pas rivaliser avec le Beaujolais, mais son vin était réputé léger.
Les fêtes populaires
Tout d’abord, il y avait la tradition des feux du Carnaval. Le soir du Mardi-Gras, tous les carrefours sont alors illuminés par les « Raillis ». Ce sont des feux de branchages, fagots et broussailles collectés par les gamins qui s’en donnaient à cœur joie à grand renfort de pétards et de déguisements. Selon la coutume, on danse autour des feux et on y jette des pierres, pour s’assurer de bonnes récoltes.
Le dimanche suivant les « Brandons », ancien nom donné au premier dimanche de Carême, on recommence ! Ce jour-là, on allumait des feux, on dansait dans les alentours et on parcourait les rues et la campagne, en portant des brandons (torches).
Le 30 avril, pendant la veillée, les conscrits, (jeunes hommes sur le point d’être incorporés dans l’armée), chantaient le mois de mai. Ils passaient dans les maisons où on leur donnait des œufs ou un peu d’argent, ce qui leur permettait de faire un bon souper.
Pour la Fête-Dieu, le curé présidait aux processions avec les enfants de chœur. On faisait aussi les processions des Rogations, qui ont lieu trois jours précédant immédiatement le jeudi de l’Ascension, afin de bénir les cultures : ces rituels devaient favoriser la prospérité des moissons.
La vogue cypriennoise avait lieu le dimanche le plus près du 16 septembre (jour de la fête de Saint–Cyprien). Le dimanche matin, les conscrits passaient pour distribuer des brioches dans les maisons avec un char enrubanné et tiré par un cheval.
La rue se garnissait d’étalages de forains (jouets, vaisselle) et l’après-midi, un grand bal avait lieu dans les deux cafés de Saint-Cyprien.
Le lundi matin, se déroulaient la course aux ânes dans la rue du bourg et le jeu des pots cassés. L’après-midi, on participait à différentes courses comme la course à la valise, la course à la grenouille, la course en sacs, la course à la bougie, etc…
Les grandes évolutions de la fin du 20ème siècle
Lors de la 2ème Guerre Mondiale, la plupart des hommes valides sont mobilisés. Cette fois, la guerre est courte, mais l’occupation est longue; il y a des restrictions de toutes sortes. Saint-Cyprien étant un village rural, les habitants ne s’en sortent pas trop mal. On raconte même qu’il y a eu un peu de marché noir…
Pour les prisonniers de guerre, la captivité est très longue, ce n’est qu’à partir d’avril 1945 qu’ils commencent à revenir au pays. A chaque arrivée, il y a une grande réception et on sonne les cloches.
En juin 1945, une grande kermesse réunit toute la population autour de ceux qui sont rentrés. La vie reprend ensuite son cours : un commando de prisonniers allemands vient même aider les agriculteurs dans leur travail.
En 1946, le repeuplement s’amorce : 496 habitants sont recensés et 2 ans plus tard, une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole est créée.
En 1955, une place est créée dans le village ainsi qu’un parking devant l’église.
Le mois de février 1956 est très froid : le thermomètre descend entre -15 et – 25°C, les céréales sont détruites, le fleuve LOIRE est gelé pendant plusieurs semaines.
Le téléphone automatique est installé à Saint-Cyprien en 1960, ainsi que le réseau d’eau potable. Un an plus tard, les chemins ruraux sont empierrés et bitumés ainsi terminé les ornières, on peut circuler en voiture. Cependant, le 7 juillet 1967, un terrible orage de grêle ravage entièrement les récoltes.
En 1968, on recense 690 habitants, la population est en nette augmentation. Ceci s’explique par l’installation d’entreprises artisanales et industrielles dans la zone de Charaboutier : forges, serrurerie, mécanique, transports… Des travailleurs étrangers (Algériens, Turcs, et surtout Portugais) viennent ainsi habiter dans le village.
Il n’y a pas de relève pour bon nombre de petits exploitants agricoles et les petites fermes disparaissent les unes après les autres au bénéfice de quelques jeunes agriculteurs qui agrandissent leurs exploitations. Malgré tout, la culture maraîchère prend toujours plus d’importance : plus de cars, plus de camions chacun transporte ses légumes au marché avec son propre véhicule. De son coté, la coopérative agricole se met lentement en sommeil, son but étant atteint : tous les cultivateurs s’équipent en tracteurs et en matériels de culture.
Le réseau d’égouts est mis en chantier en 1969 et l’année 1971 voit l’aménagement du terrain de football et d’un plateau d’éducation physique pour les écoles. Les vestiaires et les sanitaires sont terminés en 1975.
La population ayant augmenté, le groupe scolaire est construit en 1972, puis agrandi. Il comprend quatre classes (maternelles) et six classes primaires.
Dans le courant de 1978, on voit la construction d’une salle des Sports, vaste bâtiment de plus de 800 mètres carrés, permettant la pratique du basket, du volley-ball, du handball, du tennis… Elle est surhaussée d’une salle des fêtes et adjointe à une autre salle réservée au sport bouliste. Ces salles complètent l’ensemble sportif de Saint-Cyprien.
Par la suite, la vieille bâtisse qui abritait l’école communale et la mairie est démolie. L’ancienne école des filles est transformée et devient la nouvelle mairie coquette et accueillante en 1974. Concomitamment, de tous cotés, des maisons sortent de terre, constructions individuelles ou lotissements, tant et si bien que le recensement de 1976 donne le chiffre de 1 362 habitants.
Bien entendu et cela a son importance, les 20 km de voies de communication sont rénovés et maintenus en état. Tenant compte des besoins lié à l’augmentation de la population, certaines voies et rue ont été élargies.
L’agriculture maraîchère continue à tenir une place de choix dans le village grâce à la proximité de Saint-Etienne et au climat tempéré du Forez. On peut ajouter que l’attractivité et le dynamisme de la zone industrielle de Charaboutier, a fait augmenter dans de grandes proportions, la population. Elle est passée de 690 habitants en 1968 à près de 1500 en 1978.
Les animations ont toujours été présentes dans le village. En effet, il faut savoir que les deux plus anciennes associations du village sont la Boule Amicale et la société de Chasse. Elles existaient déjà avant la 2ème Guerre mondiale, ainsi que le Sou des écoles par la suite.
Depuis se sont jointes de nombreuses associations créées dans les années 1970. Comme par exemple, le Comité des Fêtes qui depuis plus de 45 ans coordonne et organise des activités festives afin d’animer la vie de Saint-Cyprien
De par sa géographie et son attractivité, il n’y a pas ou très peu de résidences secondaires, les familles préférant s’installer définitivement à Saint-Cyprien.
Gaylor MEUNIER
Sources :
– le Petit messager de Saint-Cyprien (années 1910)
– Ouvrage de Pierre Chaumarat sur l’histoire de Saint-Cyprien
– Ouvrage de Marguerite Gonon Docteur ès lettres